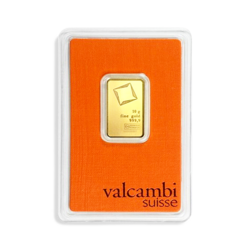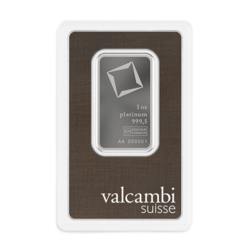Le résultat du référendum constitutionnel italien du dimanche 4 décembre est sans appel avec 60% de non et une forte participation. Matteo Renzi en a immédiatement tiré les conséquences en démissionnant de son poste du chef du gouvernement. Les questions proprement constitutionnelles sont passées à l’arrière-plan derrière l’inefficacité des réformes économiques de Mario Monti (2011-2013), d’Enrico Letta (2013-2014) et de Matteo Renzi (2014-2016), le chômage baissant à peine et la croissance ne redémarrant pas. La victoire du non signifie aussi un rejet de l’euro, largement critiqué dans la péninsule, ainsi qu’un refus des migrants.
Le processus fatal dont nous avions parlé en juillet dernier (à l’époque le référendum était prévu en octobre) risque fort de se mettre en place : de nouvelles élections, rendues nécessaires par la démission de Renzi, devraient amener, comme l’indiquent les sondages, une coalition menée par le Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo dont la principale revendication consiste en un référendum pour sortir de l’euro, qui obtiendrait sans doute la majorité. C’en serait alors fini de l’euro sous sa forme actuelle. Comment un pays de la taille de l’Italie pourrait-il sortir de la zone euro ? Nul ne le sait.
Parallèlement à cet agenda politique passablement agité, la situation des banques italiennes, qui ne cesse de se dégrader, appelle des solutions urgentes. Qui les appliquera ? Nul ne le sait vraiment. Les banques italiennes cumulent en effet 360 milliards d’euros de créances douteuses, ce qui équivaut à 22% du PIB, un ratio digne d’un pays en faillite. Les grandes banques (Monte Paschi, Unicredit, Banco Popolare) ont besoin de se recapitaliser, cela passera-t-il par des injections d’argent public, en principe interdites par Bruxelles, ou par une ponction des comptes des clients, comme le prévoit la directive BRRD ? Les deux solutions n’ont que des inconvénients, alourdissement de la dette et difficulté à trouver des investisseurs dans un cas, colère des épargnants dans l’autre.
Une calamité risque de précipiter les événements : une forte remontée des taux d’intérêt sur la dette italienne traduisant une défiance des investisseurs, le pays ne parviendrait plus à se refinancer, la faillite serait au coin de la rue. C’est la situation qu’a connue la Grèce, mais l’Italie pèse bien plus lourd avec 2.200 milliards d’euros de dette publique (300 pour la Grèce). Aucun plan d’aide ne parviendrait à éteindre l’incendie. Le risque de contagion serait réel (Espagne, Portugal, où les banques sont en mauvaise posture, la France, très impliquée dans la péninsule comme nous avons eu l’occasion de le dire).
Mais pourquoi s’inquiéter ? La Banque centrale européenne est dirigée par Mario Draghi, un italien ça tombe bien, qui a jadis dirigé la Banque d’Italie, il connaît donc bien tous ces dossiers. Il lui suffira de faire tourner encore plus vite la planche à billets, la BCE deviendrait alors le seul acheteur de la dette émise par l’Italie. Et qu’importe ce déluge de monnaie qui ferait baisser la valeur de l’euro (il a déjà commencé à reculer face au dollar), et qu’importent les protestations de l’Allemagne, ulcérée par ce laxisme. Cependant, toute cette bonne volonté ne suffirait pas si l’Italie décidait de sortir de la zone euro. On verrait alors Mario Draghi, tenant de lourdes valises débordant de billets, implorant "Comment ça, vous ne voulez plus de mon argent !" Une vraie comédie italienne.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée à condition qu’elle contienne tous les liens hypertextes et un lien vers la source originale.
Les informations contenues dans cet article ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente.