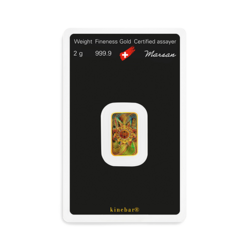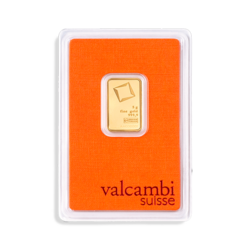Une déclaration peut parfois faire l’objet d’une bombe à retardement. Par la voix de hauts responsables politiques, l’Allemagne déclare envisager récupérer l’or qu’elle stocke aux États-Unis. Loin d'être un simple coup de communication, cette annonce traduit les profonds bouleversements qui affectent aujourd'hui le système financier international. Elle illustre, surtout, l’érosion progressive de l'hégémonie monétaire américaine désormais marquée par une perte de confiance.
En ces temps troublés, l’or n’apparaît pas seulement comme un métal. Il incarne avant tout un symbole de puissance économique qui relie toute nation à son passé et à sa souveraineté. Chaque État cherche à se protéger face à l’incertitude qui court - sur le plan financier, l’or joue ce rôle de stabilité. Cette dynamique se traduit par des achats de métal jaune, mais également par un contrôle des réserves qu’un pays détient. Car peu le savent mais l’or d’un pays est souvent conservé en dehors de son territoire national, à New York ou à Londres notamment, pour des raisons financières comme historiques (en particulier la crainte pendant la Seconde Guerre mondiale que l’or puisse être saisi par le régime nazi). Ainsi sur plus de 3000 tonnes d'or détenues par l’Allemagne - au deuxième rang des plus gros détenteurs derrière les États-Unis - environ 1200 tonnes, d’une valeur supérieure à 113 milliards d’euros, sont encore présentes dans les coffres de la Fed. Du reste, plus de la moitié des réserves de la Bundesbank sont stockées à Francfort, et une faible partie conservée à la Banque d’Angleterre.
Cet or a été accumulé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du système de Bretton Woods. À travers une relance économique sans précédent, permise notamment par l’annulation de sa dette lors du Plan Marshall, l’Allemagne de l’Ouest avait accumulé des réserves massives d’or grâce à ses excédents d’exportations. Étant donné la confiance qu’elle entretenait avec les États-Unis et la toute-puissance américaine, elle avait choisi, comme la majorité des pays européens, de déposer une partie conséquente à New-York. Certains, certes, avaient fait le choix inverse de retirer l’or qu’elles avaient précédemment stocké, dont la France sous la voix du général De Gaulle. Mais cette décision est restée marginale et la tradition a perduré après l’effondrement du système de Bretton Woods en 1971. Conserver de l’or aux États-Unis permet certains avantages : liquidité, sécurité, facilité d'accès, et alliance implicite avec la puissance nucléaire américaine. Ces avoirs garantissent par ailleurs que toute banque centrale puisse les convertir en dollars (ou toute autre devise forte) en cas d’urgence.
Mais la confiance, comme la démocratie, est un élément fragile qui risque à tout moment de se perdre. La monnaie, dont l’or fut ainsi reconnu pendant des millénaires, n’échappe pas à cette règle puisqu’elle est elle-même fondée sur la confiance. La revendication allemande de rapatrier ses réserves apparaît donc premièrement comme une réponse politique. Si l’Allemagne fait le choix de retirer l’or qu’elle détient, c’est parce qu’elle perd confiance dans son allié historique. Les États-Unis menacent aujourd’hui l’Europe sur tous les plans – économique (tarif douanier), militaire (retrait de l’OTAN), énergétique (achat de gaz de schiste américain) – et le gouvernement de Scholz est l’un des principaux concernés. À cela s’ajoute des suspicions quant à l'existence même des réserves d'or entreposées dans les coffres de Fort Knox, dont le dernier audit complet remonte à 1953. « Peut-être qu’il est là, peut-être pas. », a lancé Elon Musk. De son côté, le président des États-Unis a affirmé : « Nous espérons que tout va bien à Fort Knox. Nous allons nous rendre au légendaire Fort Knox et nous assurer que l’or est là. S’il n’y est pas, nous serons très déçus ». Dans un monde où les alliances ne sont plus que de façade, la vérification de la présence réelle de l’or aux États-Unis devient une nécessité évidente.
Avant même les nouvelles mesures tarifaires imposées à l'Europe, Berlin avait pourtant préparé le terrain. En 2020, l'Allemagne réclamait le rapatriement de la totalité de son or pour s’assurer de son existence. La guerre commerciale récemment lancée par les États-Unis n'a donc fait qu'accélérer une tendance déjà présente. Pour l’Allemagne, c’est une décision majeure car elle détient, parmi les actifs qu’elle possède dans ses réserves de change, une part importante d’or. Le métal jaune tient une place fondamentale depuis le traumatisme de l’hyperinflation de Weimar des années 1920, car il représente une ressource physique tangible qui ne peut s’effondrer, à l’inverse de la monnaie. Ainsi l’or représente près de 70% de ses réserves de change contre seulement 2% pour la Chine ou 6% pour la Suisse.
En agissant de la sorte, l’Allemagne ne fait toutefois pas figure d’exception. Elle rejoindrait des pays comme l'Inde qui a récemment rapatrié une partie importante de son or (ce qui a d’ailleurs représenté l'un des plus importants mouvements depuis 1991) ou encore les Pays-Bas qui ont organisé le transfert d'une portion significative de leurs réserves d'or vers Amsterdam en 2014. Mais surtout comme d’autres qui ont fait le choix de rapatrier leurs réserves des États-Unis, dont la Russie, le Venezuela, la Turquie… autant de pays dont les relations avec la première puissance mondiale sont particulièrement entachées. Que l’Allemagne en vienne à adopter une telle position révèle donc l’ampleur des tensions entre l’Europe et les États-Unis, au moment même où Trump a décidé de détourner son regard du Vieux-Continent pour engager son pays dans une reconquête de l’État-nation.
Cette dynamique serait lourde de conséquences. Certes, les États-Unis conservent aujourd’hui encore le plus grand dépôt mondial d’or avec New-York comme première place (où plus d’un quart des réserves mondiales d’or sont stockées). Mais cette situation pourrait s’inverser rapidement. Si l’Allemagne met en œuvre cette mesure, cela serait perçu comme un signal d’alerte que d’autres nations pourraient suivre. Aujourd’hui, plus de trente pays continuent de stocker une part de leurs réserves d’or sur le sol américain : aux côtés de grands acteurs européens comme la France ou l’Italie figurent de nombreuses puissances émergentes, dans un contexte où nombre d’États restent discrets sur l’emplacement exact de leurs avoirs. Nous pourrions alors assister à un mouvement planétaire dont les conséquences s’étendraient aux actifs financiers américains.
L’hégémonie financière des États-Unis serait fortement impactée. Toutes choses égales par ailleurs, certains pays détenteurs d'obligations du Trésor américain décideraient de s’en délester (alors même que les marchés affichent d’importantes pertes ces dernières semaines), ce qui ferait chuter le prix des obligations et augmenterait le coût de la dette. Déjà, les taux longs américains remontent depuis les annonces de Trump sur les tarifs douaniers, en contradiction avec les espoirs de maîtrise affichés par la Fed et la Maison-Blanche. La valeur du dollar, étroitement liée aux obligations du Trésor, serait davantage affectée, ce qui rendrait les importations plus coûteuses et alimenterait l’inflation. La Fed pourrait tenter d’amortir le choc en rachetant massivement des obligations, comme elle l'a fait par le passé et notamment pendant la crise sanitaire. Mais dans un contexte d'inflation persistante, cette stratégie risquerait de provoquer de nouveaux déséquilibres qui affecteraient le dollar.
Certes, les stocks d’or détenus par les banques centrales mondiales - autour de 2700 milliards de dollars - restent modestes comparés à l’ampleur du marché des Treasuries, évalué à plus de 8000 milliards de dollars. Mais la dynamique de fond joue en défaveur de Washington car la dédollarisation du monde est en marche. De nombreux pays émergents continuent de se dédollariser en achetant de l’or et la Chine, deuxième puissance économique mondiale, ne cesse de réduire son exposition au système financier américain. La tendance à suivre est enfin celle de l’Europe : avec cette décision allemande, si les pays européens suivent le mouvement - d’importants investisseurs de titres américains - c’est l’ensemble de la domination monétaire américaine qui serait remise en cause.
L’or, de son côté, ne peut recevoir ce signal que favorablement. Bien qu’une hausse du dollar n’influence plus le cours du métal jaune, la baisse de la monnaie américaine exerce sur le métal jaune une influence positive. Surtout, le choix d’un pays de rapatrier son or traduit une perte de confiance manifeste envers la nation dépositaire, les États-Unis, mais également une volonté affirmée d’accorder une place grandissante au métal jaune.
Le monde s’oriente donc discrètement vers une réappropriation de ses richesses, loin des mythes de l’interdépendance heureuse portés par la mondialisation. La décision allemande reflète à ce titre autant le grand retour du nationalisme que l’incertitude d’un monde où la loi du plus fort est devenue monnaie courante. À mesure que les équilibres mondiaux se redessinent, l’or redevient dès lors ce qu’il n’aurait jamais cessé d’être : non seulement une réserve de valeur, mais également de pouvoir. Or si l'Allemagne parvient à rapatrier l'intégralité de ses réserves d'or, le signal lancé sur le système financier international pourrait être majeur…
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée à condition qu’elle contienne tous les liens hypertextes et un lien vers la source originale.
Les informations contenues dans cet article ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente.