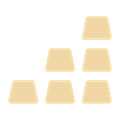Par Cordt Schnibben
Qu’il s’agisse des États-Unis ou de l’Union européenne, la plupart des pays occidentaux sont si endettés aujourd’hui que leurs politiques sont plus dictées par les marchés que par les gens. Pourquoi les pays démocratiques sont-ils si pathétiques lorsqu’il s’agit de gérer leur monnaie de façon soutenable ?
Au milieu de cette crise qui crée la confusion et qui perdure depuis plus de cinq ans, l’ancien Chancellier de l’Allemagne Helmut Kohl s’est posé la question : « Qui a plongé le monde dans tant de misère ? » Et, plus la recherche de réponses à cette question durait, plus ces réponses apportaient elles-mêmes de nouvelles questions déconcertantes. Serait-il possible que ce que nous vivions en ce moment ne soit pas une crise, mais plutôt une transformation de notre système économique qui se ressent comme une crise qui s’éternise, et qu’il serait futile d’attendre qu’elle se termine ? Serait-il possible que nous attendions encore que le monde soit conforme à notre vision globale, tandis qu’il serait plus sage d’ajuster notre vision pour qu’elle soit conforme au monde ? Serait-il possible que les marchés financiers ne redeviennent plus les serviteurs des marchés des biens et services ? Serait-il possible que les pays occidentaux ne puissent plus se débarrasser de leurs dettes, vu que les démocraties ne peuvent gérer leur monnaie ? Et serait-il possible que même Helmut Kohl devrait se dire intérieurement : « Moi aussi, je suis responsable d’avoir mis le monde dans le trouble » ?
Le film d’Hollywood le plus romantique au sujet de la crise financière n’est pas « Wall Street », ou « Margin Call », mais plutôt le film de 1995 « Die Hard : With a Vengeance ». Dans ce film, un officier de la Stasi, l’agence secrète Est-Allemande, s’empare des réserves d’or du monde occidental dans les coffres de la Réserve fédérale de New York et, supposément, les coule dans la rivière Hudson. Bruce Willis se met à la recherche du coupable et récupère les 550,000 lingots d’or qui, jusqu’au début des années ’70, représentaient essentiellement la fondation sur laquelle la confiance dans les monnaies était bâtie.
De la monnaie créée à partir de rien
Jusqu’à 1971, l’or était l’étalon du dollar US, une once d’or correspondait à $35, et le dollar servait d’étalon à toutes les monnaies occidentales. Mais quand les États-Unis eurent besoin de plus d’argent pour la guerre au Viêt-Nam, en même temps que l’économie mondiale prenait de l’expansion à un point qu’il devenait encombrant de garder l’or comme étalon, les pays abandonnèrent le système de taux de change fixes. C’est là qu’une nouvelle phase de l’économie mondiale débuta, et deux processus furent enclenchés : la libération des marchés financiers vis-à-vis des réserves limitées d’argent, ce qui fut en grande partie bénéfique; et la libération des pays vis-à-vis des revenus limités, ce qui fut en grande partie malsain. Cette bulle monétaire a continué de gonfler pendant quatre décennies, vu que les banques centrales ont pu créer de l’argent à partir de rien, que les banques semblaient à même de prêter à l’infini, et que les consommateurs et les gouvernements ont pu s’endetter sans aucune restriction.
Cela continua jusqu’à ce que la plus grosse bulle de l’Histoire commence à éclater : premièrement aux États-Unis, parce que les banques se sont servies des hypothèques de millions d’Américains, qui n’avaient comme seul actif qu’une maison achetée à crédit, pour créer des produits financiers sans valeur; deuxièmement partout au monde, parce que les banques ont déversé ces produits à des consommateurs de plusieurs pays; et, finalement, quand ces banques se sont mises à vaciller, les pays endettés ont converti la dette privée en dette publique, jusqu’à ce qu’ils se mettent eux-mêmes à vaciller et ne puissent emprunter qu’à des taux d’intérêts plus élevés que par le passé.
Pour le moment, le monde n’utilise qu’une approche pour se sortir de ce labyrinthe de dettes : encourir des milliers de milliards de dette supplémentaires.
Qu’est-ce que cela a à voir avec Bruce Willis et Helmut Schmidt ? Dans le film, Bruce Willis sauve l’or du monde et, en même temps, l’illusion du bon, vieux monde. Schmidt, en tant que Ministre des finances de l’Allemagne dans les années ’70, a donné mouvement à la spirale de dette et a contribué à répandre l’illusion en Allemagne que les pays pouvaient s’endetter, que cela serait bon pour tout le monde.
Quand le prédécesseur de Schmidt, Karl Schiller, démissionna du gouvernement pour protester contre de nouvelles dettes à hauteur de 4 milliards de deutsche-marks, il déclara : « Je ne veux pas supporter une politique qui donne l’impression que le gouvernement prône l’adage ‘Après moi, le Déluge’ ».
Schmidt endetta le pays de plus de 10 milliards de marks. Inspiré de l’économiste de crise John Maynard Keynes, le gouvernement allemand croyait que les programmes de stimulus économique aideraient à la croissance, mais seulement à condition que la dette soit réduite à nouveau quand les choses iraient mieux.
Cette politique économique était connue en Allemagne sous le nom de ‘règlementation globale’. Comme ministre des finances et, plus tard, comme Chancellier, Schmidt profita de la crise du pétrole pour augmenter le déficit gouvernemental avec des programmes de stimulus économique. Quand Schmidt quitta ses fonctions en 1982, les dépenses gouvernementales annuelles avaient triplé en comparaison des dépenses de 1970, atteignant l’équivalent de 126 milliards d’euros ($161 milliards), et la dette publique avait quintuplé à 313 milliards d’euros. Aujourd,hui, la dette combinée du gouvernement fédéral et des gouvernements locaux a grimpé à plus de 2 trilliards d’euros.
Un gêne de la dette ?
Aujourd’hui, si on met de côté toute la belle rhétorique sur l’Europe, on peut se rendre compte que l’introduction de l’euro n’est rien d’autre que la continuation de la folie de la dette en se servant de méthodes encore plus audacieuses. Les pays de la zone Euro ont profité des taux d’intérêts favorables amenés par la nouvelle monnaie pour s’endetter encore plus.
Pourrait-on mettre tout ça sur le dos d’une sorte de gêne de la dette ? Est-ce du gaspillage, de la stupidité, ou est-ce dû à une erreur dans le système ? Il existe deux visions opposées sur ce que peut faire le gouvernement pour influencer l’économie avec ses budgets : la théorie de la demande, établie par Keynes, propose de créer de la demande gouvernementale avec de la dette, ce qui génère de la demande privée et des revenus pour le gouvernement. En d’autres mots, construire une route crée des salaires pour les travailleurs de la construction. Ils paient des taxes, et ils achètent des meubles avec leurs salaires, ce qui produit des revenus pour les fabricants de meubles, et ainsi de suite.
L’autre vision, l’économie de l’offre, est basée sur l’assomption que la croissance économique est déterminée par les conditions sous-jacentes des entreprises, dont les activités d’investissement dépendent de revenus élevés, de faibles salaires et de taxes minimales. Selon cette théorie, le gouvernement encouragerait la croissance par des taxes plus légères. Dans les dernières décennies, les transitions fréquentes de pouvoir dans les pays occidentaux entre des politiciens en faveur de l’économie de l’offre (les conservateurs, les libertaires, et maintenant quelques sociaux-démocrates de centre-gauche) et ceux en faveur de l’économie Keynesienne (les sociaux-démocrates), ont fait gonfler la dette gouvernementale. Quand certains politiciens prirent le pouvoir, ils réduisirent les revenus gouvernementaux et, quand ils furent remplacés par ceux de l’autre camp, ce sont les dépenses qui augmentèrent. Quelques-uns d’entre eux firent les deux.
Quand on ajoute à la dette publique celle des entreprises et des ménages, on voit que la somme totale de la dette a augmenté à un niveau du double de la production économique depuis 1985, et elle est maintenant trois fois la taille du produit mondial brut. Pour que cela continue, les économies du monde développé requièrent de la demande financée à crédit pour croître encore... ils ont besoin que les consommateurs, les entreprises et les gouvernements s’endettent et remettent aux calendes grecques le remboursement de cette demande. Ce système porte en lui-même la compulsion à augmenter la dette, publique et privée.
Les gouvernements délèguent du pouvoir et de la force créatrice aux marchés, dans l’espoir de stimuler la croissance et l’emploi, ce qui donnerait de la latitude aux politiciens. Les budgets gouvernementaux bâtis sur la dette continuent de créer l’illusion de pouvoir... jusqu’à ce que les marchés exercent leur pouvoir par l’intérêt.
Le service des intérêts de la dette constitue maintenant le troisième élément important du budget de l’Allemagne, en termes de grandeur, et une municipalité sur trois est incapable d’amortir elle-même sa dette. Aux États-Unis, la dette nationale est passée, ces dernières quatre années, de $10 à plus de $16 trilliards, et de plus en plus de villes sont en faillite. En Grèce, en Espagne et en Italie, les marchés des obligations affectent maintenant indirectement les pensions de retraite, les provisions des budgets et même les salaires.
Un pays n’est pas une entreprise, même si certains politiciens traitent les électeurs comme des employés. La politique, c’est l’art de la médiation entre le politique et les marchés économiques; c’est de convaincre les parlements et les citoyens qu’une politique économique peut amener la prospérité et le bien commun, et de convaincre les marchés et les investisseurs que les pays ne peuvent être gérés comme des compagnies à la recherche de profits.
Après quatre ans de crise financière, cet équilibre entre la démocratie et le marché a été détruit. D’un côté, l’intervention massive des gouvernements pour sauver les banques et le marché n’ont fait qu’exacerber le problème fondamental de légitimité qui hante les gouvernements d’une démocratie. L’accusation qui revient toujours est que les riches sont protégés, tandis que les pauvres sont saignés à blanc. La première phase de la crise nous a apporté une confirmation cruelle de cette accusation, quand des propriétaires hautement endettés ont perdu le toit qu’ils avaient au dessus de la tête, pendant que les banques, qui avaient joué avec leurs hypothèques, sont restées aux affaires grâce à l’argent des contribuables.
Dans la seconde phase de la crise, après que les pays aient été forcés d’emprunter des trilliards additionnels pour stabiliser les marchés financiers, la dépendance des gouvernements sur les marchés financiers a tellement augmenté que le conflit entre le marché et la démocratie s’exprime à découvert : dans les rues d’Athènes et de Madrid, sur des talk shows en Allemagne, à des réunions au sommet et dans des campagnes électorales. Les feux de la démocratie sont dirigés vers les marchés financiers, marchés qui ne sont, somme toute, qu’un réseau silencieux de milliards de transactions par jour. Chaque petit mouvement est analysé, craint, applaudi ou condamné, et on juge les actions des politiciens selon qu’elles bénéficient ou nuisent aux marchés.
Les tentatives des pays pour sauver ce système financier qui s’effondre ont en fait augmenté leur dépendance aux marchés financiers au point où leurs politiques sont dictées par deux souverainetés : le peuple, et les créditeurs. Les créditeurs et les investisseurs veulent que l’on réduise la dette pour entrevoir la croissance, pendant que le peuple, qui veut travailler et devenir prospère, se rend compte que leurs politiciens accordent plus d’attention aux créditeurs qu’à lui. Et le pouvoir de la rue n’est rien vis-à-vis le pouvoir de certains intérêts. Le résultat est que la crise financière est devenue une crise de la démocratie, crise qui peut devenir beaucoup plus existentielle que n’importe quelle crise financière.
2ème partie : Un combat inégal
Une souveraineté harcèle l’autre, pendant que la pression des marchés doit se battre contre la pression de la rue. En Europe, particulièrement, c’est devenu un combat inégal. Depuis le 14 janvier, 2009, quand Standard & Poors dégrada les obligations gouvernementales de la Grèce, ce sont les marchés qui ont déterminé la direction et la vitesse de l’intégration européenne. Ils veulent des fonds de sauvetage de plus en plus gros, ils veulent sauver leurs investissements, ils veulent une Banque centrale européenne qui achèterait des obligations gouvernementales à l’infini, ils veulent des budgets gouvernementaux réduits, ils veulent des réformes du marché du travail comme celles de l’Allemagne, ils veulent des coupes de salaires comme en Allemagne et, en même temps, ils veulent que ces pays enfoncés dans la récession offrent des perspectives de croissance saine.
Et tout cela se passe dans une Europe dans laquelle les pays souverains ne savent pas vraiment combien d’Europe ils veulent en réalité. Les politiciens qui dirigent l’Europe ne le savent pas non plus, ce qui les rend à la merci des marchés. Ils ne disposent pas de modèle pour l’Europe, et ils suspendent les règles démocratiques de base, afin de pouvoir continuer d’agir. Ils doivent recourir à des astuces et à des interprétations extrêmes de certaines ententes pour éviter que l’euro soit détruit.
Le gouffre entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, un problème dans toute démocratie, est exacerbé en Europe par le manque de confiance entre les Européens et ceux qui prétendent vouloir régler la crise en leur nom.
Cette méfiance parmi les gouvernements européens détermine aussi les décisions qu’ils prennent. Le gouvernement allemand, en particulier, a plus confiance dans les marchés que dans les gouvernements en crise de l’Europe, et il trouve que les taux d’intérêts parlent plus fort que les promesses de réforme. La méfiance naît aussi de la relation entre les gouvernements et leurs électeurs, à un point tel qu’il est maintenant courant de retarder les décisions importantes jusqu’après les élections, pour qu’elles ne fassent pas partie des campagnes électorales. Il n’y a pas beaucoup de confiance dans le jugement économique du peuple. Si les législateurs peuvent à peine comprendre les fonds de sauvetage qu’ils votent, combien de milliards vont dans telle direction, quels sont les risques d’inflation, ce que signifient des termes comme cible, produits dérivés, effet de levier, sécurisation, à combien peut-on s’attendre que le citoyen ordinaire y comprenne quoi que ce soit ? Au minimum, le citoyen qui voudrait comprendre les problèmes sous-jacents à la crise de l’euro devrait lire les sections d’affaires des principaux journaux allemands comme le Süddeutsche Zeitung ou le Frankfurter Allgemeine Zeitung tous les jours. Regarder un talk show par semaine ne suffit pas.
Même les bonnes dettes doivent être payées
Dans cette crise, le processus de prise de décision démocratique atteint ses limites, mais même dans ces années où la dette s’accumulait, il était clair que les démocraties avaient une relation trouble avec la monnaie.
Il y avait toujours des justifications pour de la nouvelle dette. Les slogans incluaient des choses comme plus d’emploi, plus d’éducation, plus de solidarité sociale, et les élections étaient toujours en ligne de mire. On justifiait l’endettement au niveau communautaire pour augmenter le nombre de bus ou pour bâtir des terrains de jeu, au niveau des États ou régions pour engager plus de professeurs ou bâtir des infrastructures et, au niveau fédéral, pour acheter des tanks et créer des programmes de stimulus économique.
Il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette, mais même la bonne dette doit être payée. Si on regarde de plus près quels sont les pays qui s’endettent et qui paient leurs dettes, et à quel degré, on trouve une corrélation dérangeante : plus les gouvernements changent souvent et plus ils sont pluralistes, plus rapidement la dette augmente et plus elle devient difficile à payer. Plus il y a de démocratie, moins il y a de contrôle sur l’usage de l’argent. Les seuls endroits où il y moins de contrôle sont les dictatures.
Afin de tenir une administration responsable des dettes de ses prédécesseurs, les démocraties ont institué des limites à l’endettement. Quand Helmut Schmidt était à la barre, par exemple, il y avait une clause dans la Constitution de l’Allemagne qui stipulait que la dette totale ne pouvait surpasser l’investissement total. En Europe, le Traité de Maastricht, qui a pour but d’assurer la stabilité de la monnaie commune, limite le montant de dette qu’un gouvernement peut accumuler à un maximum de 60% du produit intérieur brut (PIB).
Les limites d’endettement n’ont jamais fonctionné
Jusqu’ici, les limites d’endettement n’ont jamais fonctionné dans quelque pays que ce soit. De nouvelles lois en Allemagne, qui s’appliqueront à partir de 2016, forceront le gouvernement fédéral à ne pas encourir de dettes qui dépasseraient 0,35% du PIB. Les pays-membres de la zone Euro se sont mis d’accord sur des règles similaires, mais elles ne peuvent prendre effet que si tous les parlements nationaux sont d’accord.
Dans certains pays, on voit déjà de la résistance à ces limites. Le gouvernement italien refuse d’implémenter les mesures d’austérité exigées par la BCE et d’approuver une clause stipulant des coupes automatiques de dépenses. Après des protestations des masses, le gouvernement portuguais a annulé des coupes déjà annoncées. L’Espagne n’atteindra pas la cible acceptée d’un déficit de 6,3%, mais aura plutôt un déficit prédit de 7,4%. En fait, les pays de la zone Euro n’ont pas le droit de s’endetter de plus de 3% de leur PIB.
Ce qui rend sceptiques ceux qui espèrent rééquilibrer les budgets dans les pays en crise, c’est la spirale vers le bas qui est déclenchée par ces coupes draconiennes, ces réformes structurelles et ces baisses de salaire. La demande, privée et publique, plonge pendant que l’économie rétrécit, ce qui mène à plus de chômage, moins de revenus gouvernementaux, et plus de dettes. En Espagne, après quatre séries de mesures d’austérité, le taux de chômage est passé de 8% en 2007 à 25,8% aujourd’hui, pendant que le ratio de dette du pays a doublé. Au Portugal, le chômage a augmenté de près de 100% en quatre ans, et le ratio de dette a augmenté de 72% à 114%. En Grèce, après des coupes budgétaires équivalentes à plus de 10% de la production économique totale du pays, le chômage a presque triplé et le ratio de dette a grimpé de 113% à 160%.
Ces chiffres horribles ne font pas que faire descendre les gens dans la rue, mais ils causent des conflits entre les politiciens et les économistes. Nous y voici encore, à la vieille dispute entre les supporteurs de l’économie de la demande et les supporteurs de Keynes. La croissance ne peut reprendre à moins que les budgets soient équilibrés, les taxes soient basses et les salaires encore plus bas, disent les uns; non, disent les autres, ceux qui atrophient la demande publique et privée de façon si radicale poussent les pays vers la récession et augmentent le niveau d’endettement plutôt que de le réduire. La croissance moyenne en Europe est en déclin continu; elle n’était que de 1,4% en 2011, et on s’attend à ce que l’économie rétrécisse cette année.
Pour plusieurs pays criblés de dettes, la croissance n’est qu’une de quatre possibilités pour réduire la dette. Une autre option serait d’équilibrer les budgets par des coupes et des hausses de taxes. Une troisième possibilité serait une coupe de la dette, debt haircut, ce qui signifierait une déclaration de faillite et le non-service d’au moins une partie de la dette. La quatrième voie, c’est l’inflation, c’est-à-dire laisser la dette partir lentement, sur le dos des épargnants et des consommateurs. Mais une inflation de 2-3% ne pourrait se justifier, politiquement, en Allemagne, quoique que ce serait peut-être possible aux États-Unis et ailleurs. Pour cette raison, et en réaction à la pression de l’Allemagne, les pays européens se lancent maintenant dans des programmes d’austérité très durs.
3ème partie : Dépression en Europe et le désastre japonais à venir
Parce que les gouvernements ne s’entendent pas, des entités prennent leur place, qui deviennent des presque-gouvernements : les banques centrales.
La décision de la BCE d’acheter de façon illimitée les dettes souveraines des pays européens est une alternative aux solutions politiques pour lesquelles, en ce moment, il n’y a pas de consensus majoritaire parmi les gouvernements et parlements des pays de la zone Euro. La décision de la Réserve fédérale américaine d’injecter des milliards de dollars dans les marchés, encore, pour stimuler la croissance économique, est le résultat de l’incapacité des Démocrates et des Républicains à s’entendre sur un compromis entre limiter les dettes et instaurer des programmes de stimulus. Il semble que l’impression d’argent, ou miser des milliards encore, constitue la seule réponse désespérée à la crise, des deux côtés de l’Atlantique.
Ce qui a commencé il y a quatre ans avec l’éclatement d’une bulle d’endettement dans le marché immobilier est combattu par des trilliards de nouvelle dette, ce qui ne fera que gonfler la prochaine bulle, qui sera encore plus grosse.
Ces trilliards frais circulent à travers le monde en quête de rendement, mais une petite partie seulement de cet argent coule vers l’économie réelle, où les investissements dans de nouvelles usines de production rapportent moins. Au lieu de cela, ces trilliards se promènent d’un marché financier à un autre, du marché des monnaies étrangères au marché des matières premières, et du marché de l’or à la Bourse, et ainsi de suite.
Parce que ces trilliards n’atteignent pas l’économie réelle, le risque d’inflation est actuellement plus faible que ce que voudraient nous faire croire la Bundesbank (banque centrale d’Allemagne) et son président. Mais chaque épargnant, chacun qui détient une police d’assurance-vie, paie pour cette politique de bas taux d’intérêts de la banque centrale avec, justement, ces mêmes bas taux. Quand les banques centrales gardent les taux d’intérêts près de zéro pour de longues périodes, ce qu’elles font depuis des années, elles désavantagent les épargnants ordinaires et avantagent les gros investisseurs, les parieurs et les banques, qui peuvent emprunter à bas taux et placer cet argent à profit ailleurs.
Faut-il blâmer les banques ?
Quelle est cette chose, quels sont ceux qui ont amené le monde vers tant de problèmes, et pourrons-nous nous en sortir ? Cela ne surprendra pas, l’ancien Chancellier Schmidt blâme les banques d’investissement, ses directeurs et banquiers qui ont inondé le monde de titres sans valeur, qui ont longuement spéculé sur les dettes souveraines des pays en crise, et qui ont protégé leurs risques, qui étaient beaucoup trop élevés, avec beaucoup trop peu de capital, et qui ont dû être sauvés avec l’argent des contribuables. Les banques sont encore au centre de tous les problèmes dans les marchés financiers. Elles ont toujours besoin d’argent, et elles menacent encore le système.
Et ceux qui les ont laissé devenir si puissants sont tous ces politiciens et gouvernements qui donnèrent tant de liberté au marché, qui, souvent, socialisèrent les risques, endettèrent à l’excès les gouvernements, laissèrent les municipalités, les États et les pays devenir si irresponsables. Le « marché » n’est pas un groupe d’experts, ni le dernier recours de la raison collective. C’est une orgie d’irrationalité, d’arbitraire, de gaspillage et d’égoïsme. La « démocratie » n’est pas un événement impliquant des citoyens, ou une sorte de célébration d’altruisme et de vision d’avenir, mais bien plutôt une tentative, à partir d’intérêts divergents, d’en arriver à des décisions d’une manière qui soit le plus pacifique possible.
Ensemble, le marché et la démocratie constituent ce que l’on appelle le « système ». Ce système a amené les banquiers et les politiciens à mener le monde dans la crise ou, tout du moins, on pourrait arguer en ce sens s’ils ne faisaient pas eux-mêmes partie du système. Et on pourrait se débarrasser de ce système si on en avait un meilleur.
En lieu et place, nous en sommes à voir le système sans ses déguisements. Un des effets secondaires de la crise est que toutes les coquilles idéologiques ont été incinérées. Les vérités sur la rationalité des marchés et sur la symbiose du marché et de la démocratie se sont envolées en flammes.
Les problèmes du capitalisme moderne
La dépression en Europe n’est qu’un prélude, en fait, avec le désastre japonais qui attend en coulisses. Le ratio dette/PIB du Japon est à 230%, et le gouvernement ne tient qu’avec l’approbation de l’opposition d’émettre de nouvelles obligations gouvernementales. Et il ne faut pas oublier, en derrière tout cela, la « falaise fiscale » aux États-Unis, le drame qui va se jouer à propos de la dette dans les mois à venir, les effets de scène et les duels entre Démocrates et Républicains pour savoir quel parti pourra blamer l’autre pour une faillite nationale.
Alors, finalement, nous avons une vue claire des trois plus gros problèmes de ce capitalisme, constitué démocratiquement et conduit par la finance : premièrement, comment une économie endettée peut-elle grandir si une large part de la demande, dans le passé, était basée sur la dette, et que cette dette doit maintenant être réduite ?
Le second problème majeur du capitalisme est le suivant : comment reprendre la bride des marchés financiers déchainés, et comment les pays du G-20 peuvent en arriver à des règles communes pour les grosses banques, qui sont leurs financiers et créditeurs, et pour les marchés, qui punissent et récompensent ces pays via l’intérêt ? De combien de liberté ont besoin les marchés financiers pour servir de lubrifiant à l’économie mondiale, et quelles limites devrait-on leur imposer afin que les banques, les « banques de l’ombre » (shadow banks) et les fonds de placement ne menacent pas le système ?
Troisièmement, comment les gouvernements peuvent-ils être les médiateurs entre les pouvoirs des deux souverainetés, comment peuvent-ils rétablir la primauté des citoyens sur les créditeurs, et comment la démocratie devrait-elle fonctionner dans les pays criblés de dettes ? Comment les politiciens peuvent-ils réagir sans endetter encore plus les pays, et comment peuvent-ils réduire cette dette ? Par le passé, les revenus futurs ont été hypothéqués dans les villes, les États et au gouvernement fédéral. Ce qui rend difficile la restructuration pour maintenant et plus tard. Aujourd’hui, il n’y a que 20% du budget fédéral qui est disponible, politiquement, tandis qu’il y en avait 40% de disponible quand Schmidt était en fonction.
Ce n’est qu’au premier coup d’oeil que l’on voit le monde dans une crise de la dette, une crise financière et une crise de l’euro. En fait, le monde est au centre d’un processus massif de transformation, d’un changement profond à notre système rendu à un stade critique et criblé de dettes, ce qui nous appauvrira et détruira notre prospérité, notre sécurité sociale et la démocratie, et il est au centre d’un renversement qui se passe dans le dos de ceux qui sont en charge.
Les mises sont très hautes, c’est un jeu de poker avec des trilliards entre ceux qui achètent du temps avec l’argent des banques centrales et qui croient pouvoir continuer comme avant et les autres, qui craignent la plus grosse bulle d’endettement de l’Histoire et cherchent des façons de se sortir d’un capitalisme basé sur de l’argent emprunté.
Source originale: Spiegel
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée à condition qu’elle contienne tous les liens hypertextes et un lien vers la source originale.
Les informations contenues dans cet article ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente.